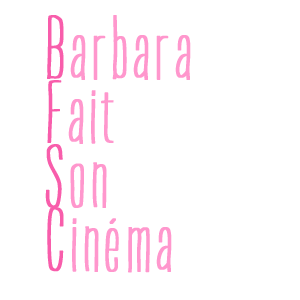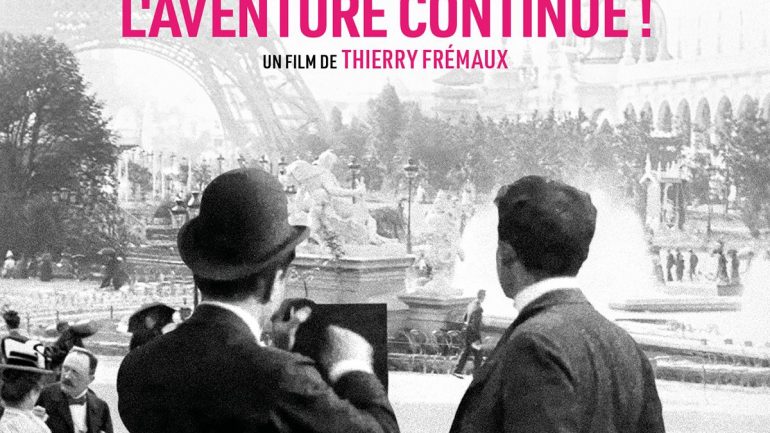Jour 3 et un agacement. Un vrai. LES FILLES DU SOLEIL le film d’une femme en compétition (oui puisqu’on en est à compter les femmes en compèt). Ce film ne m’a pas plu pendant, et m’agace d’autant plus après – maintenant donc. Comme le disait si bien Edouard Baer durant son discours d’ouverture, il fait partie des films dont je me fous pendant et après.

Un sujet grave et important : la guerre au proche Orient, ses morts, ses familles et personnes endeuillées, et cette vie qui n’en n’est plus une lorsque l’on passe son temps à tenter d’échapper aux bombes, à survivre à ceux qui nous manquent et à manquer de tout, au coeur des débris matériels et de l’âme humaine. Un sujet fort donc. Dont il faut parler.
Sauf que, pas de cette façon. J’ai trouvé le film d’une banalité affolante, mal interprété, pas convainquant.
Faudrait-il, sous couvert qu’il narre l’histoire vraie d’un bataillon de femmes ayant vaincu les islamistes dans leur contrée, aimer et croire en ce film ? Je ne le crois pas et je n’en n’ai en tout cas, aucune envie.
J’ai trouvé le tout trop appuyé, et ai senti – ce que je déteste au cinéma – cette volonté de « faire du buzz » et cette palette de bons sentiments. Or, on ne fait pas de cinéma avec des bons sentiments. Ou si peu.
Le scénario parsemé de flashback nuit même au propos je trouve. C’est larmoyant au possible sauf que je ne suis émue à aucun moment.
Les dialogues sont d’une platitude assez extrême et le tout donne ce sentiment terrible d’être pris en étaux entre ce que fait la réal de ses actrices – toutes des héroïnes – et de son film, cette histoire.
Le générique de fin est peut-être le pire de tout. Emmanuelle Bercot qui joue ici une reporter de guerre, nous lit l’article qu’elle a tiré de sa mission auprès de ce bataillon de femmes. Un style journalistique aussi miteux que le film lui même !
Des poncifs et encore des poncifs. Rien de pire pour rendre hommages à ces femmes, « héroïnes, oubliées de l’histoire qui la forge chaque jour. »
En compétition pour la palme, sérieusement Thierry Frémaux ?
S’en est suivi une attente pour 3 FACES de Jafar Panahi. 2 heures, sous la pluie. Une pluie torrentielle. Je n’aurais pas résisté pour grand monde. Mais Jafar, oui. Pas d’hésitation. Et il me l’a rendu. Il nous dit une nouvelle fois l’importance majeure du cinéma dans sa vie. Pour rappel, Jafar Panahi, réal iranien est assigné à résidence et n’à plus le droit de tourner pour avoir, dans ses films précédents osé critiquer le pouvoir en place. En soi, savoir qu’il tourne toujours et encore tient du miracle, car il a connu les geôles d’Iran et je me doute que cela doit ressembler au pire. Il continue sa route. Il fait des films avec des brics et des brocs (une go pro, dans sa voiture, avec ses amis et sa famille en guise d’acteurs) mais il est là. En pleine création, à l’ouvrage. Et qu’il m’émeut ! Car son cinéma est vrai justement. Aucun gras, simplement la volonté de dire son amour du cinéma et son importance majeure : parvenir à faire entendre sa voix – quelle qu’elle soit – pour tous et vis à vis de tous. La Liberté dans toute sa splendeur. Sa simplicité nous apparaît ainsi comme étant la plus grande vérité du monde. La valeur première du monde. La liberté. Ça me touche au plus haut point.
Voir qu’il garde toujours sa part d’humour me plait, je trouve cela irrésistible ! Il narre ici le route d’une jeune fille qui rêve de faire du cinéma mais en est empêchée par une famille – un frère notamment – qui dicte sa loi et l’assigne à résidence. J’ai aimé cette épopée. L’un des plus beaux trajets de ce Festival cannois. J’ai hâte d’accrocher à nouveau ma ceinture à droite de Monsieur Panahi.
Direction ensuite La Semaine de la critique (présentation de 1ers et 2èmes films, l’endroit où il est possible de découvrir les nouvelles pépites), pour voir NOS BATAILLES avec Romain Duris, Laetitia Dosch et une petite fille géniale de retenue et de répondant. Je suis toujours ébahie lorsque je vois des enfants jouer de façon aussi naturelle et travaillée / professionnelle.
Toujours est-il que ce film est une pure réussite. Romain Duris que j’aime dans tous ses rôles y est particulièrement touchant, vrai, puissant et d’un naturel dingue.
Il incarne un ouvrier, père de famille devant faire face au départ de sa femme. Comme ça, du jour au lendemain, sans un signe avant coureur, elle n’est pas allée chercher les enfants à l’école, à pris ses affaire et est partie sans un mot et sans une adresse.
Il faut le voir avancer, gérer, sans courber l’échine. Ou encore le voir parfois fendre l’armure mais pour toujours rester digne et vrai et droit. J’aime qu’il se fonde à ce point dans un rôle.
Qu’il nous dise à la fois les batailles d’un père de famille, de celles d’un homme de conviction fortement impliqué dans la vie sociale de son environnement professionnel et de celles d’un homme – imparfait, sensible et perdu. C’est franchement beau et prenant.
Le film mêle ainsi social et intime et le fait avec brio. Les messages passent, sans jamais une lourdeur ou un faux pas. Du cinéma dégraissé au possible et intelligent.
À ses côtés Laure Calamy (l’assistante dans 10%) que je trouve définitivement géniale et Laetitia Dosch qui a un charisme dingue. Elle dégage une énergie et parsème ce film (et les autres) de son aura à la fois délicate, forte et subtile. Une grande actrice.
Et puis cette scène – lorsque les acteurs n’ont plus les mots, ce sont alors Les Paradis Blancs de Michel Berger qui prennent le relai et disent la difficulité de vivre parfois, les douleurs de la vie. Et puis vient cette fin, lumineuse et positive qui dit la possibilité d’un après, d’une reconstruction, d’une attente non plus passive mais active et c’est alors la vie qui reprend, qui continue.
Un « père courage » dans toute sa force et ses fêlures beau à en pleurer.