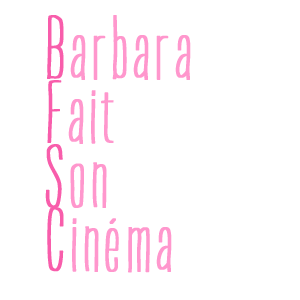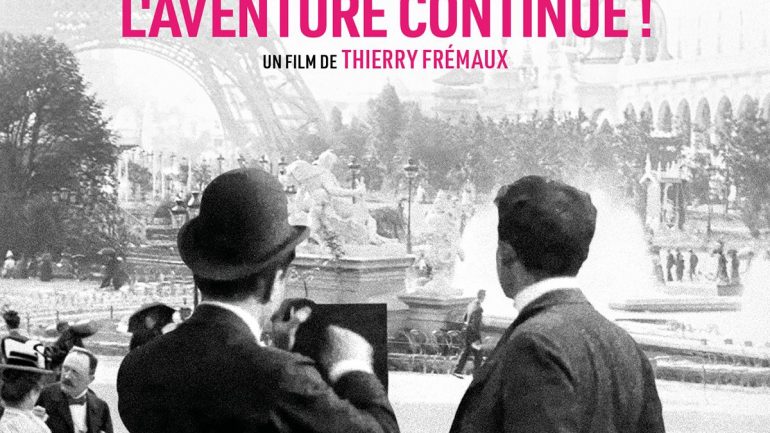La lumière du titre, c’est lui : Roshdy. Il attrape la clarté comme jamais. La caméra le suit dans ses déambulations nocturnes au gré des affaires qu’il est amené à résoudre. Il est commissaire de police à Roubaix. La misère l’environne dans cette ville autrefois ouvrière au sein de laquelle les dernières usines ont fermé pour laisser ses habitants exsangues, livrés à eux mêmes, dépourvus de tout.
C’est ainsi qu’il croise la route de deux jeunes femmes, amantes, accusées d’avoir tué leur voisine, une ville dame de 83 ans, pour une affaire de télé et de quelques sous. Sordide. Son quotidien.
Daoud, c’est le nom du commissaire, ne se départit jamais de son emblématique flegme et de cette humanité qu’il semble être le seul à avoir conservée dans cet environnement marqué par la révolte. Il a ce « je ne sais quoi en plus » qui fait sa force : il sait aussitôt si la personne qu’il reçoit en audition est coupable ou non. C’est qu’il est du coin, semble avoir pas mal baroudé, n’a ni espoir ni amertume. Il est bien ancré, et a pris le temps d’analyser la vie avoisinante, d’analyser la vie. De l’art de voir les gens, l’autre… de le comprendre dans sa diversité et son altérité. Il est de ceux qui portent l’Humanité en bandoulière ou au creux de leurs mains. Et cela, Roshdy Zem avec sa carrure et son regard tendre et solaire l’incarne à merveille.

Quel plaisir de le voir débarquer dans l’univers de Desplechin. Il apporte de suite une caution romanesque quoi que très terrienne au film, à cette affaire d’affaires innommables.
C’est ainsi qu’il est le fil conducteur de ce film inégal à mon sens. Lent, parfois trop et sans doute trop appuyé.
Léa Seydoux sait pleurer, elle le prouve une fois de plus, mais je ne parviens jamais vraiment à la suivre. Sara Forestier en revanche prouve une fois de plus que la brutalité qu’elle porte en elle sert son art. Elle parvient en un quart de seconde et surtout en un mouvement de tête à dire la violence, les blessures, la difficulté à être soi, parfois, dans un monde qui laisse pour compte les plus démunis, les plus fragiles.
Reste alors un conte de Noel tout de même drôlement ficelé, aux allures de « fait d’hiver » qui décompose et recompose les codes du polar et emprunte au film documentaire. C’est riche et ça dit beaucoup de ces espaces de vies où prédomine le réel en opposition à nos sociétés évoluant désormais dans des artifices instagramables. Desplechin s’affaire à nous livrer ici un film de terrain, un film du réel très ancré, sans aucune once de fabuleux.