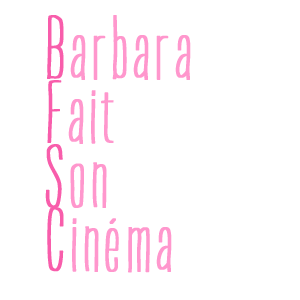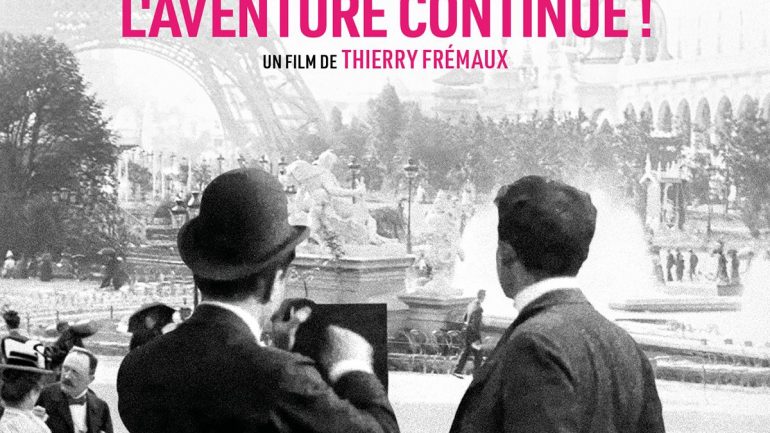« A mes enfants, à mes petits enfants, à mes arrières petits enfants qui vont poursuivre le chemin tracé ».
C’est l’histoire d’une famille, une histoire d’une famille en particulier mais c’est tout autant l’Histoire, la grande Histoire de l’humain. C’est en cela que le nouvel opus de Maiwenn résonne tant. En moi en tout cas.
Elle, si habituée à faire du cinéma que l’on pourrait qualifier « d’autobiographique » se défend de faire du cinéma sa catharsis. Pour l’avoir entendue en interview promo, elle explique que ses films, certes basés sur des faits réels, sont le résultat d’un travail sur elle même effectué par ailleurs mais que le cinéma ne lui permet en aucun cas de s’affranchir de ses douleurs du passé. Les films qu’elle créé ne lui servent pas d’échapatoire, ce n’est pas de cette façon qu’elle perçoit son métier et son utilité. Ca se défend.
Elle incarne pourtant , à mes yeux, au travers de ses films, l’essence même du Cinéma : un amas de brics et de brocs, des décors, des acteurs qui disent un texte, du montage pour un tout qui vient dire et montrer le réel, et le sublimer.
Ici, c’est la mort du pilier de la famille, le grand père qui a joué tous les rôles : celui de père, de grand père, de confident, de militant… Celui qui a édifié la tour familiale et a tracé le sillon et la route sur laquelle avance aujourd’hui sa descendance. Voilà longtemps que je n’avais pas été touchée de la sorte par une histoire familiale portée au cinéma. C’est même au contraire, un style de cinéma qui me crispe souvent. Tour à tour trop démonstratif ou pleurnichard… je n’aime généralement – au même titre que dans la vraie vie – que l’on s’attarde trop, que l’on s’épanche sur les affaires familiales. Mais il y en a deux qui transcendent ça ; Kechiche et Maiwenn. Et leur cinéma m’embarque et me touche au plus haut point. Car il sonne si vrai. Il porte en lui une vraie incarnation.

Sans doute cela est-il dû au fait qu’ils laissent tous deux tourner la caméra pour saisir des moments, somme toute, de vérité. Du moins des moments desquels parvient à s’extraire une certaine vérité. Et c’est là l’essence même du cinéma.
On pourra reprocher pas mal de choses à Maiwenn mais pas le fait de ne pas être vraiment à ce qu’elle fait. Elle est à mon sens une grande réalisatrice. Une grande, très grande directrice d’acteurs et d’actrices. Le regard qu’elle pose sur sa caméra et sur les gens qu’elle filme est d’une douceur mêlée à toute la poigne qui est la sienne. Je sens dans chacun de ses films cette volonté de décrire, décrypter et montrer quelque chose. Rien n’est laissé au hasard. Ca peut sembler basique de dire ça mais il y a tant de films qui se cherchent, qui laissent du gras. Chez Maiwenn je me retrouve face à un film débarassé du superflu, face à un film idéalement calibré qui ne retient que la sève, qui n’a jamais aucune fioriture, qui cherche la flamme, qui cherche à dire son sujet, et qui par conséquent frappe fort.
Que ce soit un neveu orphelin qui voue au grand père qui l’a élevé un amour inconditionnel (sublime Dylan Robert que j’ai découvert dans le choc Shéhérazade et qui confirme cette puissance brute de jeu) ou une mère et une fille qui ne se comprennent pas magré l’amour qu’elles se portent (grandiose Fanny Ardant qui semble encore nous donner quelque chose de nouveau, de neuf, d’expurgé de tout ce qu’elle a pu jouer jusque là : le propre d’une grande actrice) ou encore deux soeurs qui se jalousent sans doute, qui en tout cas ne s’entendent pas et vont se retrouver dans la douleur de cette perte. Sans plus d’explication que ça. C’est ça le cinéma de Maiwenn : une certaine vérité mais pas d’explications. Les choses arrivent, on les filme sans chercher à en décortiquer le fond. Il faut que ça parle vrai. C’est du cinéma naturaliste. Un ersarz de quotidien ou soyons d’accord sur ce point, on n’analyse pas tout à chaque instant. Le rendu n’en est que plus fort car brut. Peu poli.

Ce film est en fait comme notre ADN, il porte en lui toutes ces particules que l’on porte en nous, et qui forment un tout. Ce que nous sommes. Vous. Moi. Nous.