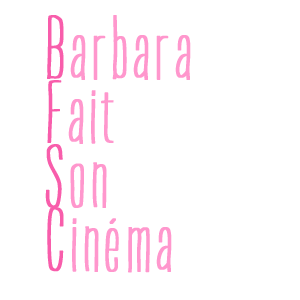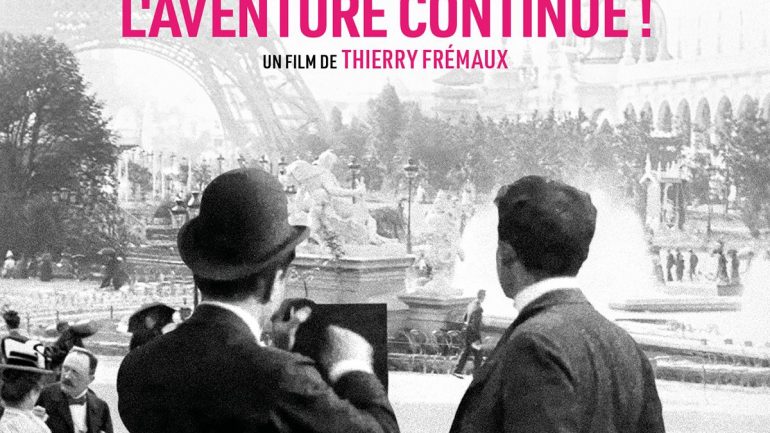Me voilà de retour sur la Croisette, et cette année pour 6 jours de festival. Le retour du temps long cannois moi qui, depuis 2019, n’avais pas passé plus de 3 jours sur place. L’occasion donc de renouer avec l’ambiance, avec les réveils qui piquent, avec les montées des marches, avec les déambulations parfois très rapides entre deux projections… avec toute l’effervescence et la puissance que charrie en lui le plus grand festival de cinéma du monde.
L’occasion de renouer avec la légère nostalgie qui nous envahit alors qu’il faut (déjà) quitter les lieux, de déconnecter de la billetterie, rentrer.
C’est dans cette période faite de souvenirs forts et d’excitation d’un palmarès qui répond en tous points à mes attentes, que je vous livre ici le récit de mes séances cannoises.
Tout commença par la projection d’Emilia Perez, le nouveau film de Jacques Audiard, cinéaste que j’aime tant (si vous me suivez depuis des années vous savez à quel point son cinéma me touche, son questionnement constant sur la relation au père, l’humanité qui se dégage de ses personnages souvent brisés par la vie en route vers une rédemption…) Des années que j’entends parler de ce nouveau projet : « une comédie musicale tournée au Mexique ». J’avoue avoir été déçue de sa tentative westernienne (Les frères Sisters) et me souviens m’être dit lorsque j’ai entendu parler de ce projet que j’aimerais qu’il revienne à ses films plutôt classiques tels que Sur mes lèvres, De Rouille et d’os, De battre mon cœur s’est arrêté et l’immense Un prophète…

C’était sans compter la puissance du propos qu’il insuffle dans chacun de ses films qui leur donne une âme, cette dose d’humanité si chère car peu présente dans le cinéma actuel. Un cinéma qui parle vrai, qui dit le monde, nos sociétés et leur évolution et surtout, qui prend le temps de se déployer, et de dire l’humanité capable de se nicher jusque dans les basfonds, parfois chez les gens les plus mal perçus et jugés par la société. Son cinéma est ainsi, pour moi, une véritable source de vie.
J’ai retrouvé tout cela, et plus encore, dans ce film présenté en compétition officielle. Soit l’histoire d’un narcotrafiquant mexicain transsexuel en route pour enfin vivre sa véritable identité. La question du genre est ainsi au cœur du film, les sujets chers au cinéma d’Audiard sont là aussi comme la relation au père, et le manque du père… C’est aussi et surtout un film très féminin avec des rôles de femmes indépendantes, d’autres soumises à la bêtise humaine d’un patriarcat en bout de course, luttant alors pour leur survie, pour que leur place soit reconnue. Des portraits de femmes debout qui prennent leur destin en main.
L’insertion d’interludes musicaux donnent au film toute sa structure et je garde en tête une scène de danse particulièrement puissante (celle de la soirée de gala) ; Zoé Saldana y est impériale. Celle qui mène la danse et tire à elle toute lumière c’est Karla Sofia Gascon : l’actrice principale qui joue Emilia et, au début du film, le narcotrafiquant dont je parlais. Il faut la voir à l’œuvre. On la sent puiser au fond d’elle pour incarner ce double rôle, faire ce voyage inverse, elle qui est née dans ce corps d’homme qu’elle a subi, puis quitté. Elle est incroyable d’abnégation et de cette puissance fragile qu’ont ceux qui sont passés / passent par des gros tourments mais ont en eux, toujours, la fragilité, et au fond la certitude que les choses se mettront en place, comme elles doivent.
De cette volonté qui vous amène à vous démener. Karla Sofia est de celles-là. Elle irradie et nous a émue lors de la réception de son prix, à Cannes. Le jury, présidé par Greta Gerwig, a en effet remis aux actrices du film un prix groupé d’Interprétation féminine. Karla Sofia entre ainsi dans l’Histoire en étant la toute première femme transgenre à recevoir ce prix. C’est grand, à l’image de son parcours, à son image.
Le film sortira en salle le 21 aout.
La suite du programme de ce J1 fut tout autant impériale puisque j’ai fait la montée des marches, aux côtés de l’équipe du film The Substance signé Coralie Fargeat, une réal française dont j’ignorais tout. Elle débarque sur la croisette avec son second opus aux cotés d’un casting 3 étoiles qui permet à Demi Moore de fouler le sol de Cannes pour la toute première fois, Margaret Qualey (que l’on a découverte dans Once Upon A Time in Hollywood) et Denis Quaid. Je passerai vite sur le rôle pénible de ce dernier qui incarne la beaufitude sans demi-mesure, Demi et Margaret portent le film.

Un « body horor » (j’ai appris ce terme cette année) qui n’est pas là pour épargne nos sens. Genou qui craque, colonne vertébrale qui se brise, accouchement par le dos (je ne sais comment vous présenter les choses autrement, soyons factuels !), peau qui suinte, ongle qui s’arrache et j’en passe…. Tout est là pour nous faire gigoter sur nos sièges.
La réal est allée jusqu’au bout de son projet, elle ne recule devant aucune peur d’aller trop en profondeur ni trop loin. Des réal hommes l’ont fait avant elle (on pense bien sûr à Cronenberg avant tout), pourquoi renoncerait-elle. Une façon, féministe s’il en est, de s’imposer dans ce pan d’un paysage cinématographique encore trop perçu comme étant masculin.
Ajoutons à cela Demi Moore (61 ans, dont on parle beaucoup du physique) qui joue justement sur cette image. La réalité d’Hollywood (et plus largement) n’est autre que passé un certain âge, vous n’êtes plus rien, comme périmée. C’est d’une violence terrible. Ce monde terriblement basique et superficiel se complait à ne rechercher que la fraicheur, la pureté, la délicatesse… autant de qualificatifs uniquement liés à la jeunesse. Comme si passé l’âge de quarante ans, une femme n’était plus en mesure d’être fraiche, pure ou délicate…
Coralie Fargeat nous invite ainsi à repenser nos critères d’appréciation de la femme. Elle le fait par le prisme des codes du film de genre et c’est une réussite. Une réussite grinçante que je n’aurais pas récompensée par ce Prix du Scénario (peut-être l’aspect le moins probant de son film) mais par un prix de Mise en scène… Mais ce n’est pas de mon ressort et le principal étant que le film soit vu et reconnu pour ce qu’il est.
Une nouvelle brique du cinéma gore inspiré de nombre de ses prédécesseurs. On voit et on pense en effet aux oeuvres les plus célèbres de Cronenberg, mais aussi au cinéma de genre comme Shining et Requiem for a dream pour le montage bien particulier…