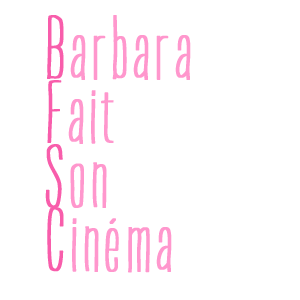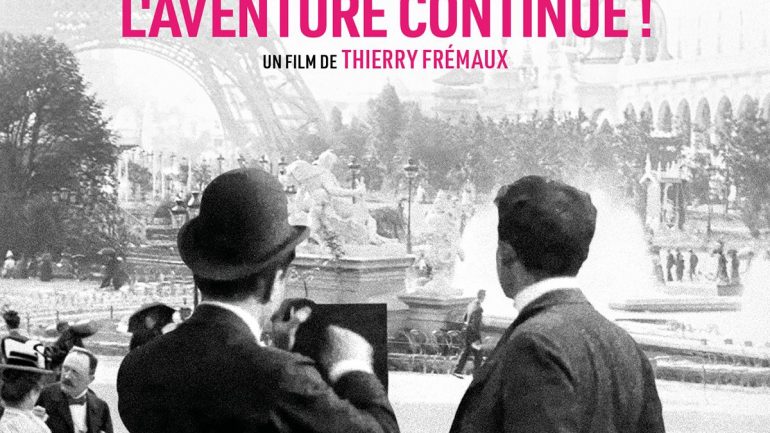Ce film est né de la volonté de François Ozon de « filmer des hommes en train de pleurer ».
De recherches en réflexion, l’oeil d’Ozon – cinéaste que j’admire énormément, tant il parvient à réinventer son cinéma à chaque film – s’est alors porté sur l’Affaire Barbarin. J’ai lu qu’il avait un temps songé à en faire un documentaire pour choisir au final d’illustrer à l’écran la douleur des victimes au travers d’un long métrage.
On suit alors, sous la forme d’un triptyque (film sur la religion catholique oblige ?) le parcours et le quotidien de trois hommes, issus de milieux différents, ayant un style de vie différents… unis par le souvenir du drame de leur enfance.
Le film s’ouvre alors qu’Alexandre Melvil Poupaud, parfait, découvre que le Père Preynat qui a alors abusé de lui lorsqu’il était sous sa responsabilité en tant que scout, est de retour à Lyon et toujours au contact d’enfants.
Ni une ni deux, il lance des démarches au travers d’une correspondance épistolaire, avec pour objectif d’apporter preuves et éléments qui pourraient mener à la création d’un dossier pour enfin déchoir le prêtre de sa fonction.
Dès lors, je suis emportée par le film qui mêle divers styles et caractéristiques propres au cinéma. Le fait de se savoir au plus proche de l’actualité (le procès dit de « l’affaire Barbarin » est en cours) apporte le sentiment étrange de savoir à chaque instant ce qu’il va se passer mais Ozon, en grand maitre du cinéma, sait conjurer cela en ajoutant à chaque plan, à chaque scène la force d’une matière cinématographique incroyable !

La caméra est toujours à la place idéale. Elle filme, semble vouloir collecter les preuves mais ne juge jamais. Elle est très clairement du côté des victimes mais ne se veut jamais rebelle, encore moins violente.
Ozon cherche une vérité. Pour y parvenir, il questionne la foi. Sans réussir à obtenir une réponse mais en nous donnant à chaque instant des bribes de vérité sur la nature même de l’Homme. Sa capacité à se cacher derrière toute sorte de préceptes, derrière toute sorte de non dits. Pire encore, derrière cette institution qui nous semble alors inébranlable.
Très vite, dès la seconde partie du film durant laquelle Denis Ménochet puis Swann Arlaud (puissants, o combien puissants) arrivent, Ozon change de braquet et film le groupe. J’ai alors pensé à 120 BPM, ce choc cinéma, qui filme lui aussi le collectif, ses batailles d’idéaux, sa fougue, ses incompréhensions parfois. Mais son élan.
C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’apparaît Josiane Balasko dont la présence m’a bouleversée. Elle est épatante de justesse dans le rôle de cette mère qui se ronge les sangs de n’avoir rien vu à l’époque des faits. La voir renaître grâce à la fonction qu’elle va mener au sein de l’association des victimes est d’une grande justesse et beauté.

C’est cela le cinéma d’Ozon, parvenir à dire beaucoup avec peu de mot. Par « l’usage » précis et minutieux de ses acteurs, de leur corps, de leur regard…
Restent justement ces regards, tous apeurés et meurtris de l’horreur qu’ils ont subi, mais fiers et tenaces, faisant front à une Eglise immobile vraisemblablement abîmée de trop de non dits et de secrets.
Ces regards qui disent enfin tout sont eux, sont tournés vers demain.
Regarde les hommes pleurer…